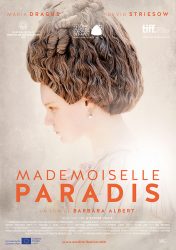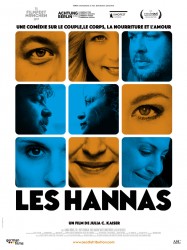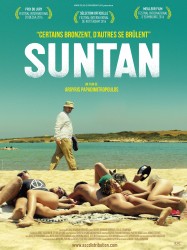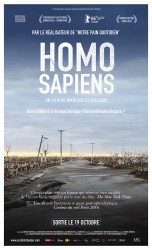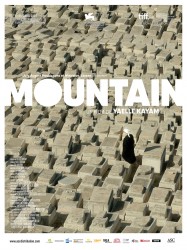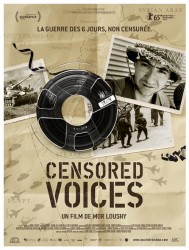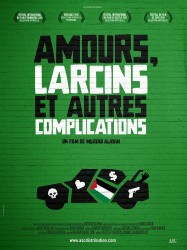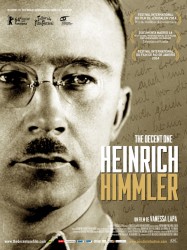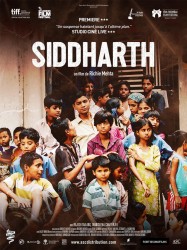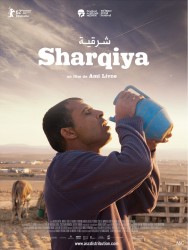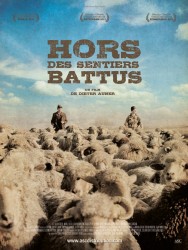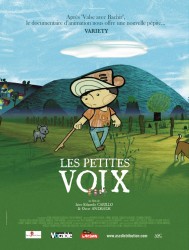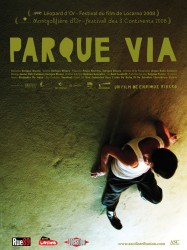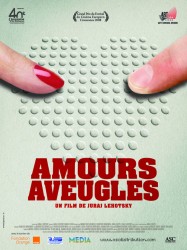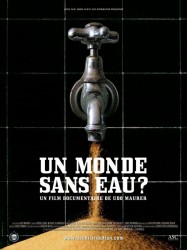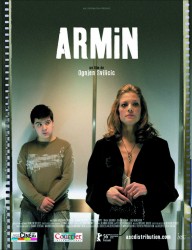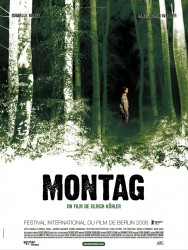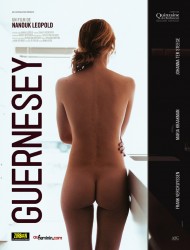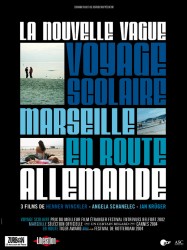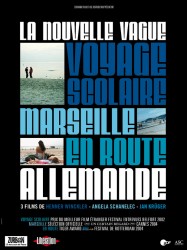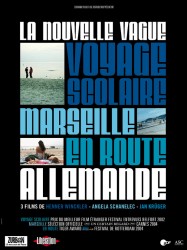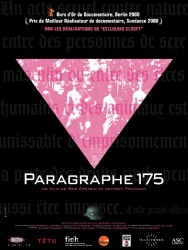Caractéristiques
- réalisateur : Ragnar Bragason
- année de production : 2006
- date de sortie : 4 juin 2008
- durée : 92 minutes
- pays : Islande
- festivals : –
Synopsis
Karitas est une mère célibataire de quatre enfants qui essaie désespérément de faire des rencontres. Elle mène une bataille perdue d’avance avec son ex-mari pour la garde de ses trois filles.
Elle ne prend pas conscience de ce qui arrive à son fils de douze ans, Gudmundur, qui est le souffre-douleur de ses camarades de classe, et dont la vie suit le chemin de la destruction.
Son seul ami dans ce monde est Marino, un schizophrène d’une quarantaine d’années, qui vit avec sa mère. Quand Marino réalise que sa mère a rencontré un homme en secret, il commence à perdre prise sur la réalité.
Gardar est une petite frappe dont la conduite nuit à son frère jumeau Georg.
Rejeté à la fois par le milieu et par sa famille, il doit prendre un nouveau départ dans la vie, et décide de partir à la recherche de son fils, Gudmundur, qu’il n’a jamais vu, mais rester dans le droit chemin est quelquechose de difficile à suivre.
Revue de presse
Evene.fr
L’Islande en noir et blanc. Evidemment. Bien que l’histoire puisse se passer n’importe où, l’atmosphère insulaire oppressante se dégage des images. Ragnar Bragason raconte le choc de quatre destins qui se rencontrent, dans un univers froid (et pour cause), violent mais non dénué d’optimisme. Une mère de famille, un adolescent souffre-douleur, un schizophrène et un gangster à la petite semaine composent le quatuor gagnant de cette galerie de martyrs. L’esthétisme épuré de la réalisation ne laisse pas le droit à l’erreur, et les acteurs principaux s’acquittent de leur tâche de piliers avec talent. Tous sont excellents, à commencer par Gisli Örn Gardarsson, Gardar dans le film. La qualité du scénario, imprévisible, n’empiète pas sur la mécanique de la loi du Talion mise en place dès le début. Les coups sont rendus, dent pour dent, jusqu’à l’explosion finale. Savoir contre qui est dirigé ce déluge de haine importe moins que de suivre jusqu’au bout les réactions des protagonistes. Sans parler de happy end, la dernière séquence se fait joviale, aux antipodes du dénouement attendu. Tout est bien qui finit bien ? Pas tout à fait : la prison sociale reste fermée, les liens familiaux brisés sont à peine reconstitués… Il reste l’expérience vécue du gâchis, de la violence comme seule échappatoire.
Le Monde
Children” : portrait de moeurs à l’islandaise
Pas question de filmer des gens sympathiques ni de signer un film rassurant. Ragnar Bragason veut coûte que coûte être au diapason de la vie réelle, cela signifie pour lui un refus délibéré du divertissement. Est-ce à dire que ses personnages sont des monstres, des repoussoirs ? Ils sont tout simplement englués dans un marasme existentiel débilitant. Au cinéaste de faire le constat de ce mal d’être, en cherchant pourquoi ces gens en sont arrivés là. A nous d’assister à ces malédictions familiales, sans défaillir.
Le ton sans concessions de ce portrait de moeurs est donné d’emblée. A propos de l’animal prétendument domestique qui rôde dans un coin, on nous prévient que : “Si t’es un connard, il mord !” Mais au fur et à mesure que nous découvrons les âmes en peine et les bourreaux de Children, on se rend compte qu’ils n’ont qu’une raison de vivre comme des chiens : le manque d’amour.
Voilà Karitas, mère célibataire, quatre enfants (elle dit “garnements”), infirmière. Elle mène une bataille perdue d’avance avec son ancien mari pour la garde de ses trois filles et délaisse son fils de 12 ans, Gudmund, que la douleur de n’être pas choyé pousse à des gestes agressifs, comme flanquer le chat dans le vide-ordures.
DESTINS EN IMPASSE
Souffre-douleur de ses camarades de classe, ce gamin blondinet à la mine sombre va voir son père resurgir du néant, une fripouille qui martyrise son propre frère et que son rejet du milieu délinquant (ainsi, sans doute, que quelques remords) pousse à retrouver trace de sa progéniture qu’il n’a jamais vue. La mère de Gudmund voit le retour de ce sale type d’un très mauvais oeil (“cet homme est dangereux”, dit-elle, elle n’a pas tort), mais le môme est subjugué…
Par ailleurs, Gudmund s’est lié d’amitié avec un certain Marino, un schizophrène en costume-cravate de 40 ans, boulimique donc obèse, fumeur compulsif, collectionneur de nécrologies. Ils jouent au foot, s’occupent de leur poisson rouge fétiche. Tous les deux se sentent abandonnés par leurs mères, qui travaillent trop, essaient désespérément de faire des rencontres. Marino frise l’hystérie ; il ne supporte pas que sa mère fréquente un homme à son insu.
De cette accumulation de destins en impasse, le cinéaste tire un film sans illusions, en noir et blanc, mais pas sans humanité. Tout le monde a ses raisons de souffrir, ou de faire souffrir sans le vouloir. L’explication des troubles dépressifs ou hyperviolents des uns et des autres est à chercher chaque fois dans le déficit affectif de la mère, alors que tous ces mauvais garçons voudraient voir manifester à leur égard un amour exclusif. Or celles-ci doivent gagner l’argent du ménage, et leur désir de se trouver un compagnon est légitime. Admirateur de Mike Leigh et de John Cassavetes, Ragnar Bragason travaille avec la compagnie théâtrale la plus créative d’Islande : VesturPort, productrice de ce film ainsi que de celui que Bragason a réalisé en écho, Parents.
Fondé sur l’improvisation, Children résulte d’une création collective. Chaque comédien a composé son personnage, plus ou moins tiré de son expérience personnelle. Ce processus de happening s’avère artistiquement probant, même s’il donne un état de santé effarant du paysage social islandais.
Libération
«Children», l’île de la claustration
Bref récapitulatif. L’Islande est une grande île frisquette, certes européenne mais un peu paumée vers le cercle polaire, sa capitale est Reykjavik et le pays compte, tout compris, 310 000 habitants, dont Björk. A part cette dernière, les distractions y sont rares, les paysages urbains sont d’une gaieté à s’ouvrir les poignets, le tissu social est presque consanguin compte tenu de la faible densité de population et la météo est en noir et blanc. Tout comme Children dont le seul fait qu’il soit islandais constitue une carte d’identité singulière.
Poire. Le film de Ragnar Bragason parle de la solitude ou plus exactement, de l’isolement. L’isolement d’une poignée de gens, étouffant silencieusement dans le carcan de leur existence banale à pleurer. Les uns sont résignés, d’autres tentent de se révolter mais personne n’y échappe. A chaque plan, chaque dialogue, on reçoit en pleine poire le désespoir qui suinte de tous les côtés. Bragason joue sur tous les registres de cet autisme de société, de l’incompréhension tragique à l’absurde confinant à la comédie. Le réalisateur, qui concède volontiers son admiration pour Mike Leigh, Jean-Luc Godard et John Cassavetes, a travaillé pendant plusieurs mois avec la troupe de théâtre Vestuport pour préparer deux films, Children donc, et Parents, pas encore sorti en France. Au programme de ce collectif, création des personnages par les comédiens eux-mêmes, improvisations et écriture du scénario dans lequel chaque individu croise les autres, leur parle parfois, les affronte ou les méprise, mais ne les entend jamais. Chacun est définitivement seul avec lui-même, dans une angoissante autarcie intellectuelle et sentimentale.
Parmi les principaux protagonistes, on trouve Karitas, la jolie mère célibataire de quatre enfants qui ne s’en sort pas, voudrait bien que son ex-mari lui foute la paix, un homme de temps en temps et surtout comprendre ce qui ne va pas avec son fils aîné Gudmundur. Le gamin d’une blondeur hypnotique est le souffre-douleur de ses camarades d’école et passe ses journées à taper dans un ballon au pied de son immeuble. Sur la pelouse pelée, il croise parfois Marino, un trentenaire schizophrène, obsédé par la bouffe que lui administre à volonté sa mère, et qui passe sa vie à craindre que cette dernière ne l’abandonne. Il y a aussi dans le paysage l’inquiétant Gardar, voyou à la petite semaine, toujours flanqué d’un monstrueux molosse, qui a une fâcheuse tendance à distribuer des torgnoles avant de réfléchir. Il est tellement con et maladroit, Gardar, qu’il met en péril son propre frère jumeau Georg, chétif et peureux.
Miroirs. La comédie humaine de ces naufragés sociaux constitue la chair de Children. Un jeu de miroirs où, à force de perdre de vue le reflet des autres, chacun finit par s’égarer pour de bon. Ici, dans l’intimité poisseuse de sa petite prison personnelle, l’enfer, c’est définitivement, soi-même.
Telerama
Children
Un film islandais, c’est assez rare sur nos écrans. A priori, on imagine un univers à la fois plein de blondeur, de lumière et d’une certaine noirceur sociale ; un mélange de gravité et d’humour pince-sans-rire. On a grosso modo raison. Hormis deux scènes ouvertement comiques (la première, très réussie, et la toute dernière), le film met en scène des personnages paumés, tous en proie à une forme de violence : un voyou au bord de la rédemption ; une infirmière célibataire qui jongle avec le temps pour élever seule quatre enfants ; son fils aîné, souffre-douleur de l’école ; un schizophrène amoureux de sa mère. Pour raconter ces trajectoires qui se se croisent, le réalisateur, auteur de clips et de publicités, a choisi le noir et blanc et misé sur l’improvisation des comédiens, tous épatants. Ils tissent une galerie de personnages attachants jusque dans leur face noire, une chronique sociale sombre et authentique, pleine d’énergie et de vérité.