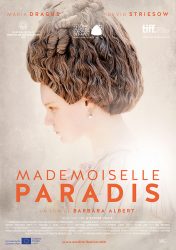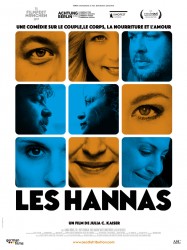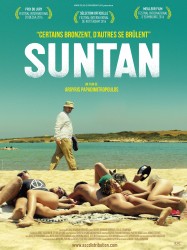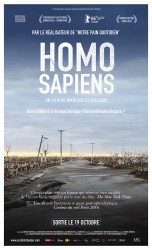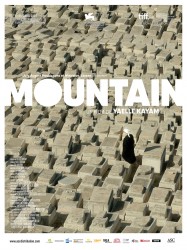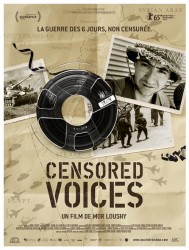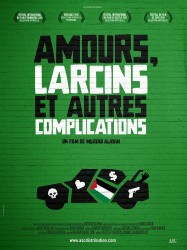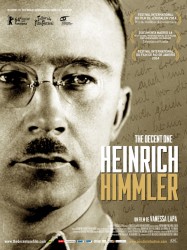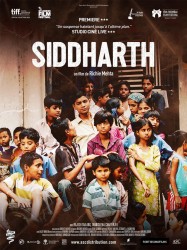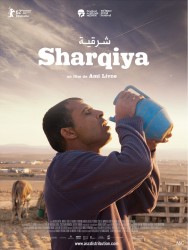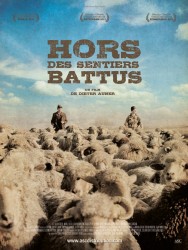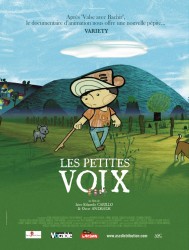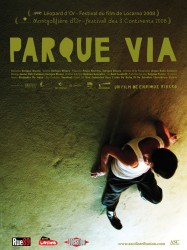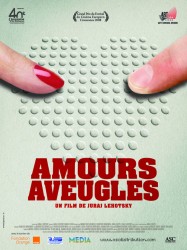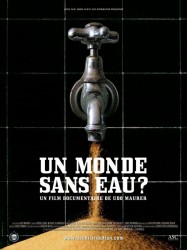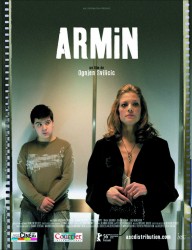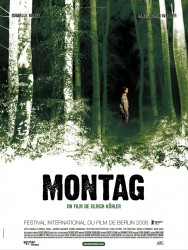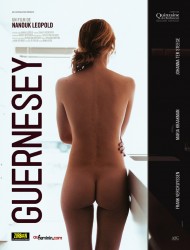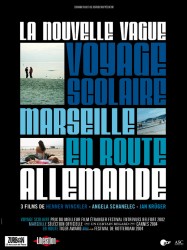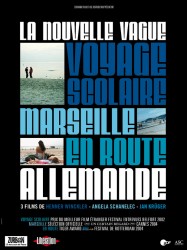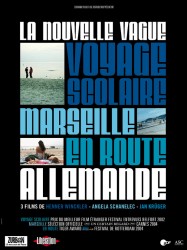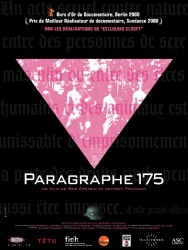Caractéristiques
- réalisateur : Sebastain Silva
- année de production : 2009
- date de sortie : 14 octobre 2009
- durée : 95 minutes
- pays : Chili
- festivals : Sundance 2009 Meilleur film étranger – Meilleur actrice – Festival Paris Cinéma 2009 Prix du public
Synopsis
Raquel, une femme ombrageuse, travaille depuis vingt trois ans comme domestique chez les Valdes, une famille de la bonne société de Santiago du Chili. Lorsque sa patronne embauche une autre domestique pour l’aider, Raquel a l’impression qu’on lui prend sa place dans la famille. Elle tend des pièges à chaque nouvelle venue. Aucune ne tient le coup. Jusqu’à ce qu’arrive Lucy, une femme de province pleine d’humour, qui touche le cœur de Raquel et change sa façon de voir la vie.
Revue de presse
Les Inrockuptibles
Portrait de famille avec nounou psychotique. Un film chilien inquiétant et fort. Quelques années après la nouvelle vague argentine, aurions-nous le plaisir d’être arrosés d’une mini vague chilienne ? Après l’excellent Parque via, voilà le remarquable La Nana. Attention au titre faux ami : ce film de Sebastian Silva n’est pas une relecture personnelle de Zola ni une comédie teenage façon Les Beaux gosses. La « nana », c’est l’équivalent latino de la nounou ou de la nannie, la domestique qui tient la maison, élève en partie les enfants, habite dans les combles et ferait presque partie de la famille de ses employeurs.
Le film de Silva commence justement par explorer cette zone frontière ambiguë qui rappellerait presque l’un des motifs de La Règle du jeu de Renoir. Dans la situation des employé(e)s de maison, il y a ce brouillage pas toujours aisé entre la barrière patron/salarié et la proximité-promiscuité induite par la présence pérenne sous le même toit.
Ainsi, quand la famille prépare une petite fête d’anniversaire pour leur « nana », Raquel, celle-ci préfère rester terrée dans sa cuisine, comme murée dans son rôle social. Pudeur ? Timidité ? Conscience sociale aiguisée ? Réticence à quitter ne serait-ce que l’espace de quelques minutes sa condition de domestique ? Refus de ce qu’elle perçoit comme de l’hypocrisie ? Le film ne tranche pas, et petit à petit, La Nana quitte la thématique intéressante mais prévisible de la lutte des classes en petit périmètre pour glisser vers des régions plus mystérieuses et surprenantes. Il apparaît que Raquel est quelque peu psychotique : elle ne supporte pas que l’on fasse le boulot à sa place, devient agressive quand sa patronne souhaite engager une deuxième domestique pour la soulager de sa charge de travail. Raquel est assujettie, mais sa condition d’aliénée est aussi ce qui la structure. Les séquences où la « nana » doit partager son travail avec des collègues successives qu’elle perçoit comme des rivales sont à la fois très drôles, très inquiétantes et très noires. On sent que la « folie » de Raquel peut la faire basculer dans une violence incontrôlable. On pense alors furtivement aux Bonnes de Genêt, à La Cérémonie de Chabrol. La troisième domestique à l’essai, une jeune étudiante joggueuse et ipodeuse saura ouvrir le système de défense de la « nana » dans une dernière partie que l’on ne dévoilera pas.
Une grande partie de la réussite de ce film réside dans son excellent casting, au sommet duquel trône l’incroyable Catalina Saavreda, une actrice habituée au registre comique qui campe la « nana » avec une force et une subtilité impressionnantes. Mais le regard de Sebastian Silva est lui aussi impeccable.
Circulant fluidement à travers la maison, sa mise en scène figure parfaitement les questions de territoires, de séparation et de promiscuité qui forment l’un des enjeux de son film. Il évite aussi le tract idéologique facile en croisant la thématique de la barrière de classe avec les portraits humains, résistant ainsi à un tableau manichéen qui opposerait des patrons salauds à une domestique victime.
Que l’on regarde l’originalité de son sujet, le déroulé de son récit (on ne sait jamais trop où l’on nous emmène), la virtuosité modeste et non apprêtée de sa mise en scène, ou la qualité de ses acteurs, pas de doute : cette Nana-là mon vieux, elle est terrible !
Serge Kaganski
Le journal du Dimanche
La bonne crise
Taiseuse et hommasse sur les bords, Raquel a travaillé toute sa vie au service d’une famille bourgeoise affectueuse à son égard, et assez attachée à elle pour penser à lui fêter ses 42 ans. Sa patronne croit d’ailleurs agir pour son bien lorsqu’elle embauche une seconde servante. Erreur. Plus fragile qu’il n’y paraît, Raquel a des montées d’angoisse. A sa nouvelle collègue, elle va mener une vie d’enfer…
Primé cette année à Sundance et au festival Paris Cinéma pour ce second long métrage émouvant et maîtrisé, le Chilien Sebastián Silva (La Vida me mata) signe ici un très beau portrait de femme au bord du précipice.
Le film la cueille déjà psychologiquement exsangue. Excellente comédienne dans le rôle-titre, Catalina Saaverda est connue au Chili pour ses personnages comiques au théâtre et à la télévision.
Dans ce rôle complexe et poignant, parfois effrayant mais non dénué de pointes d’humour, elle est magistrale.
Alexis Campion
Téléciné Obs
Voilà vingt-trois ans que Raquel travaille comme domestique chez les Valdes, à Santiago, au Chili. Ses patrons sont aisés et prévenants. Raquel, qui ne prend jamais de congés et a coupé les ponts avec les siens, pourrait presque se sentir de la famille, n’était la différence de condition (elle mange à la cuisine et les cadeaux qu’on lui fait pour ses anniversaires n’ont rien à voir avec le train de vie de la maison). Lorsque sa patronne décide de la décharger d’une partie de ses tâches (écrasantes) en engageant une autre employée, elle se sent littéralement dépossédée de ses prérogatives, s’arrange pour faire déguerpir les candidates les unes après les autres jusqu’à ce qu’enfin l’une d’elles réussisse à lui montrer les limites de sa condition – employée de maison et non membre à part entière de la maisonnée – et lui ouvre les portes de sa cage dorée.
Numéro un du box-office chilien, le deuxième film de Sebastián Silva, qui a également conquis le public du Festival de Sundance avant de s’attirer les faveurs de celui de Biarritz (Catalina Saavedra, qui joue Raquel, y a remporté le prix d’interprétation féminine), s’attarde avec une délicate acuité sur les relations paternalistes entre patrons et employés, et brosse, à travers le portrait de Raquel, celui d’une catégorie d’aliénés, aimante, effacée et totalement frustrée.
Marie-Elisabeth Rouchy
Le Monde
“La nana” : Dominant et dominé entre quatre murs
Longtemps, les cinémas d’Amérique latine furent dominés par une dimension ouvertement militante. La jeune et talentueuse génération de cinéastes qui se lève aujourd’hui a recours à une autre voie, plus intime et formaliste à la fois, pour témoigner de l’aliénation du continent. La relation maître-domestique semble ainsi devenir une figure récurrente de ce cinéma, illustrée par exemple dans Bataille dans le ciel et Parque Via, respectivement signés par les réalisateurs mexicains Carlos Reygadas et Enrique Rivero.La Nana, deuxième long métrage du jeune réalisateur Sebastian Silva, nous plonge à son tour au coeur de cette relation trouble, sans manichéisme aucun, en même temps qu’il nous envoie, par son indéniable réussite, le signe que quelque chose d’intéressant se passe aussi, désormais, dans le cinéma chilien, après la découverte de l’admirable Tony Manero (2009), de Pablo Larrain.
Petits secrets
Nous voilà donc enfermés avec l’héroïne, Raquel, bonne dans une belle maison bourgeoise de Santiago du Chili dont l’enceinte compose le cadre de ce huis clos. La maison appartient à la famille Valdes : père sympathique et vaguement démissionnaire, affairé à ses maquettes et à ses parties de golf clandestines, mère affable, partagée entre la gestion de la maisonnée et son travail, enfants déjà grands, sans autres problèmes que ceux qui se posent à une adolescence protégée et choyée.
Au cœur de ces murs, où une chambre lui est réservée, Raquel, une quadragénaire usée et morose, occupe une place à la fois centrale et annexe depuis plus de vingt ans. Centrale, parce qu’elle fait partie des meubles, qu’elle a vu grandir les enfants, et qu’aucun des petits secrets de la famille ne lui est étranger. Annexe, tout simplement parce qu’elle occupe une place de domestique.
L’ambiguïté de cette situation, avec ce qu’elle comporte de trivialité et de non-dits, est parfaitement mise en scène par Sebastian Silva. Tout s’y joue entre quatre murs, dans une promiscuité qui ne cesse de désigner ce que l’on voudrait justement escamoter : la relation dominant-dominé. D’où ce sentiment de familiarité poisseuse, dont le galvaudage tient à la fois à la culpabilité implicite de cette famille progressiste et à la manière dont la bonne, qui n’est pas dupe, parvient habilement à en tirer quelque maigre profit. A cet état de fait si finement cadré s’ajoute, pour les besoins de la dramaturgie, la dynamique d’une action : le désir de la maîtresse de maison d’engager une aide pour Raquel, qui marque des signes de fatigue. Manière de relancer l’ambivalence d’un geste affectueux, néanmoins motivé par une logique utilitariste.
Ici s’ouvre ce qui devient l’argument essentiel du film, et en même temps la peinture d’un degré supérieur d’aliénation. Car Raquel, paniquée, se met à défendre bec et ongles son territoire, dont la cruelle ironie de l’histoire est évidemment qu’il n’est pas même le sien. Raquel, adoptant une technique tristement signifiante (elle enferme ses ennemies dehors), mettra ainsi hors jeu deux postulantes, une jeune Péruvienne et une vieille grognarde envoyée tout exprès par la grand-mère, avant que la troisième, une jeune femme de la campagne, ne fasse enfin bouger sa ligne de défense. Une fin relativement émolliente eu égard à la cruauté et à la justesse du tableau général n’empêchera pas de recommander ce film très prometteur.
Jacques Mandelbaum
Libération
C’est un film qui pose la question de la servitude volontaire. Comment peut-on désirer sa propre répression ? A l’échelle de l’histoire, ce sont les millions d’Allemands qui ont démocratiquement voté pour le régime nazi. A la fenêtre, nettement moins dramatique, d’une chronique familiale, c’est l’histoire de Raquel, domestique depuis vingt-trois ans chez les Valdes, famille aisée de la bonne société de Santiago du Chili. Mais du macro ou microcosme, la même question s’obstine : comment peut-on désirer sa propre répression comme s’il s’agissait d’un combat pour la liberté ? Comment peut-on aller jusqu’à aimer cette répression ? La Boétie dans son Discours de la servitude volontaire, l’écrivit beaucoup mieux : «Les hommes nés sous le joug, puis nourris et élevés dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés et ne pensent point avoir d’autres biens ni d’autres droits que ceux qu’ils ont trouvés ; ils prennent pourleur état de nature l’état de leur naissance.» C’est sous ce signe anxieux que, tel un La Boétie contemporain, le film de Sebastián Silva, jeune réalisateur chilien de 30 ans, s’exprime. Avec beaucoup de subtilités. Car les Valdes ne sont pas des monstres esclavagistes, bien au contraire. Nouveaux bourgeois progressistes, ils considèrent Raquel comme un membre de leur famille, le film s’ouvrant sur un gâteau d’anniversaire qui fête les 40 ans de celle-ci – Raquel -, la nana, la «bonne» en espagnol chilien. Sauf que certains cadeaux sont gênants, voire insultants : un pull moche, plutôt Prisu que Prada. Ce qui suggère que Raquel est aussi comme un animal domestique, un bibelot du décor.
Perle rare. De son côté, Raquel n’est pas présentée comme un ange de subordination, une martyre idéale. Elle a, comme on dit, son caractère, plutôt mauvais, qui peut la conduire à tyranniser une partie des membres de la famille : la fille aînée et ses façons de jeune pétasse, qu’elle punit à sa façon fourbe (un petit chaton chéri de la gamine sera vite balancé par-dessus le mur) ; le jeune fils cadet dont elle dénonce à ses parents les trace de foutre dans les draps. Même la patronne résiste mal au chantage larvé de Raquel, perle rare qui menace en permanence de rendre son tablier. Le choix de l’actrice Catalina Saavedra est une belle trouvaille. Venue de la télé chilienne où elle jouait les comiques, elle est tout d’une pièce, tout d’un corps, à la fois lourd et aérien.
Le film est jalonné de ce genre de subtilités qui à la fois raffinent le propos académique (maître, esclave et tout le tintouin dialectique) et rendent tangible sa complexité. Par exemple certains plans qui insistent sur l’intimité et la promiscuité : la chambre de Raquel, autant niche que sanctuaire, et son lit à une place où parade une collection de peluches enfantines. Mais aussi le quasi-documentaire sur le «service», ce travail de bonne, bonne vraiment à tout faire, qui, du petit-déjeuner au coucher, traverse la vie de ses patrons comme si elle était invisible. Et encore, épisode le plus troublant du film, ce moment où sa patronne ayant engagé une jeune fille pour soulager son labeur, Raquel fait subir à cette bonne de la bonne, cette plus damnée qu’elle, une terreur sadique raffinée.
Coup de torchon. La Boétie de nouveau s’impose : «Quel malencontre a été cela, qui a pu tant dénaturer l’homme, seul né de vrai pour vivre franchement ; et lui faire perdre la souvenance de son premier être, et le désir de le reprendre ?» La nana est fille de «malencontre», ce mélange de mauvaise rencontre et de malchance qui s’amplifie jour après jour, de coup de torchon en coup de blues, de mal-être en mal au crâne, au point que l’amour de la servitude se substitue au désir de liberté. Jusqu’à une libération malgré tout, qui ne surgira pas de la lutte des classes mais d’une fraternisation surprise avec une énième domestique embauchée pour l’aider. L’estime de soi, c’est l’estime des autres. La nana a retrouvé son nom : Raquel, belle et rebelle.
Gérard Lefort
Télérama
La « nana », en espagnol, c’est la berceuse, la nounou. Un euphémisme pour dire ce qu’est en pratique Raquel dans la grande maison où elle travaille et dort depuis plus de vingt ans : la bonne à tout faire. On est à Santiago du Chili, mais pour la plus-value exotique, on repassera. Le film (multiprimé au festival de Sundance) montre une bourgeoisie mondialisée, à peu près identique à celle de nos quartiers chics. L’altérité, la différence, ça se passe d’abord et avant tout entre les riches et les pauvres, entre les dominants et les dominés.
Malgré toute la tendresse compassionnelle que la famille aisée témoigne à sa domestique – on fête son anniversaire, chacun y va de son petit cadeau -, Raquel est profondément asservie.
Sa condition sociale a fini par s’inscrire dans sa chair (fatigue, malaises, médocs…), dans sa façon de penser : elle est devenue son identité même.
Sebastián Silva, jeune réalisateur chilien qui, dit-il, a grandi entouré de bonnes, réussit donc, d’abord, ce constat clinique glaçant, perçant : sous l’apparence de la normalité, voire de l’harmonie, une relation maître-esclave.
En permanence, Raquel est à la fois intégrée à la cellule familiale et remise à sa place par un geste « anodin » (une porte qu’on referme sur elle), un mot « malheureux » («Après tout, tu n’es que la bonne, ici»). Cela se corse encore quand on lui adjoint une aide, avec qui elle doit partager son territoire – la maison, la famille, c’est sa chose.
Ce mouvement du film, qui pousse le personnage dans ses retranchements les plus pathétiques, et les plus féroces, se charge de suspense, d’angoisse. Il reflète aussi de façon criante un type de pression – sur les travailleurs – caractéristique de l’économie libérale.
Officiellement recrutée pour seconder Raquel, la « nouvelle » bonne représente à ses yeux une rivale au sang neuf, un danger de mort, et les « patrons » ne l’ignorent sans doute pas.
Comme le temps a passé depuis Les Bonnes, de Jean Genet, et même depuis La Cérémonie, de Claude Chabrol… La fracture sociale est si bien intégrée par tout le monde comme une donnée indépassable que les envies de meurtre ne sont plus dirigées contre les bourgeois : « la nana » n’en veut qu’à ses semblables, ses doubles…
Au lieu d’un rebondissement à résonance révolutionnaire, le film s’achemine ainsi vers la simple possibilité d’un moindre mal. Une manière de s’accommoder de l’ordre du monde ? Pas si simple. Car d’un bout à l’autre de cette chronique d’une belle acuité, le cinéaste se tient du côté de son héroïne opprimée. Et l’élan qu’il sait lui communiquer in extremis, c’est déjà une petite déclaration d’indépendance.
Louis Guichard